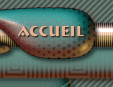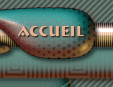Organiser
est une forme importante de création
Je trouve malheureux que l'acte de créer ne soit la plupart du temps qu'associé aux domaines artistique et littéraire. S'il existe un secteur où un créateur peut voir, observer, proposer, réaliser et se réaliser, c'est celui de l'organisation. Entendons alors ici par création le fait de prendre ce qui est désordonné pour en faire un système qui fonctionne bien et qui répond aux attentes des gestionnaires, des utilisateurs et de ceux et celles qui ont à le tenir à jour quotidiennement.
Un jour que je venais de décrocher un nouvel emploi où j'avais la responsabilité de toutes les communications d'un organisme, je fus étonné de constater que des milliers d'exemplaires des quelque deux cents titres qu'avait publiés cet organisme se trouvaient pêle-mêle sur des tablettes où chacun se servait. Il n'existait pas de méthode de codification, pas de système de classement des originaux, aucun suivi de la distribution ni quelque rudiment d'inventaire que ce soit. Pour ce qui est titres qui devaient être vendus, ils pouvaient très souvent être obtenus gratuitement grâce aux bons services d'un copain ou d'un copain d'un copain qui travaillait dans la "boîte". Personne ne semblait s'être jamais étonné d'une pareille situation.
J'exigeai d'abord un local qui fermait à clé. Après avoir attribué un code à chaque publication, je constituai une banque d'originaux soigneusement classés. Les exemplaires de chaque titre furent comptés puis méthodiquement rangés sur des tablettes où, bien en évidence, chaque pile était identifiée par son code. Je fis ensuite développer un programme informatique qui permettait non seulement la gestion de l'inventaire des titres, mais qui rendait également possible d'effectuer le suivi de la distribution de chacun de ces titres. Le renouvellement des stocks pouvait donc être fait au moment opportun et des rapports de distribution pouvaient être produits pour une période donnée.
Certes, tout cela n'eut pas été possible si je n'avais pas eu un patron qui me faisait confiance et qui m'accorda ce qui était nécessaire à l'accomplissement de mon projet.
C'est cependant moi qui ai réfléchi longuement à la façon de bâtir un système qui tiendrait compte des éléments déjà en place, les titres des collections par exemple, pour trouver toute une structure qui permettrait une gestion efficace et facile. Bien sûr, il fallut vaincre des réticences et développer de nouvelles façons de fonctionner comme celle qui consistait à enregistrer la sortie de chaque exemplaire d'une publication.
Le système fonctionna si bien que par la suite, il servit de structure à une base de données textuelles que l'on rendit accessible sur Internet. Il permit aussi de rationaliser les tirages et d'implanter l'impression à demande.
J'ai eu souvent à organiser divers projets. Dans tous les cas, la démarche était la même. Il fallait d'abord constater que quelque chose ne fonctionnait pas dans une organisation donnée. Après avoir bien observé les déficiences de la situation, il fallait réfléchir à ce que pourrait être une organisation qui, en plus de régler des problèmes existants, apporterait plein de plus-values au travail qui devait être fait. Il faut, bien sûr, avoir raison des résistances, mais un projet bien monté et bien défendu y parvient habituellement.
L'organisation créatrice tirait sa source d'un étonnement : comment peut-on fonctionner avec un tel système ? Ne serait-il pas possible de voir la situation dans son ensemble, de l'examiner sous toutes ses coutures, pour ensuite passer à l'action, en l'occurrence organiser pour mieux travailler.
L'organisation demande un effort, un engagement, un désir d'agir : il serait en effet beaucoup plus facile de laisser les choses comme elles sont. Mais l'action procure de doux plaisirs puisqu'il ne faut pas que penser un système dans sa globalité. Chacune des composantes demande réflexion, analyse, jugement critique, défense de ses idées auprès de ceux qui peuvent décider d'une part, et auprès de ceux qui auront à utiliser, d'autre part.
L'organisation apporte des joies : celle de bâtir d'abord, mais surtout celle de voir qu'un système qu'on a imaginé et développé fonctionne et remplace le chaos. L'organisation simplifie en remplaçant l'à-peu-près par l'ordre et par des données palpables. Et quand des gestionnaires et des collègues sont capables d'oublier un instant leur ego, ils vous complimentent et vous disent que vous avez bien travaillé.
Quand on sait que dans une organisation, les gestionnaires sont responsables de 85 % des erreurs alors qu'ils ne possèdent que 15 % de l'information, en même temps que les travailleurs de la base, qui possèdent 85 % de l'information, ne commettent que 5 % des erreurs, je crois qu'il y a, dans toute organisation, une bassin de créateurs qui, souvent, ne demanderaient pas mieux que d'organiser ce qu'ils connaissent bien, si seulement l'occasion leur en était donnée. Des Mozart assassinés peuvent, si l'occasion leur en est donnée, devenir des créateurs d'envergure.
Il m'arrive d'imaginer tous les efforts, tous les tourments, tout l'argent qui seraient économisés si plus de choses étaient mieux organisées. Et cette organisation, bien comprise, allierait saine gestion et beauté même si cette beauté ne répondrait pas aux canons généralement admis.
L'homme contemporain
est un touriste généralisé
Une des dernières choses que je fais le soir avant d'aller au lit est de jeter un coup d'œil sur mon agenda. En quelques instants, je sais de quoi sera fait demain : sur quels dossiers je travaillerai, qui je rencontrerai, quelles sorties je ferai. Compte tenu d'habitudes et de contraintes qui se sont installées au cours des années, je peux prévoir où je déjeunerai, ce que je mangerai, quels loisirs meubleront mes temps libres.
Au fil des ans, je suis devenu de moins en moins libre de mon emploi du temps, des choses à voir, des personnes à rencontrer, des gestes à poser. Je suis un touriste à l'itinéraire soigneusement tracé, dans sa propre ville, dans sa rue, chez lui.
Autrefois, une grande partie du rythme de la vie était défini par la nature elle-même avec ses saisons, les terres qu'elle offrait pour la culture et la récolte, les matériaux qui étaient disponibles pour la construction. Aujourd'hui, alors qu'on a aboli en grande partie les frontières du temps et de l'espace et que l'on jongle avec des concepts tels que la mondialisation, nous assistons à un nivellement, souvent par la base, de la façon de se loger, de se nourrir, de s'habiller, de se divertir, d'être.
Si, au premier coup d'œil, je ressens une certaine fierté à habiter dans un appartement que j'ai décoré selon mes goûts, un regard plus attentif me montre que presque tout est fait selon des normes bien précises : hauteur des plafonds, surface des pièces, construction des fenêtres. Qui plus est, ces normes ne s'appliquent pas uniquement à mon environnement immédiat; il y a beaucoup de chances qu'elles aient été adoptées par l'ensemble des pays dits industrialisés et que je retrouve à des kilomètres de chez moi une porte identique à celle qui mène à mon patio.
La préparation, la présentation et les méthodes de vente de la plupart des biens, y compris la nourriture, ont beaucoup de chance d'être identiques où que je me trouve sur une bonne partie de la planète.
Les divertissements que l'on me propose, que ce soit à la télé, au cinéma ou au club vidéo, voire à une salle de spectacle voisine, sont également offerts à l'humanité toute entière, du moins à la partie de celle-ci qui a les moyens de se les offrir.
Les moyens de communication, qu'ils appartiennent à "quincaillerie", comme les ordinateurs, ou qu'ils soient un véhicule plus noble, comme la langue, ont de fortes tendances à se standardiser. On est alors branchés ou on ne l'est pas.
C'est ainsi que l'homme contemporain est devenu un touriste généralisé. Il peut rester dans son environnement pour y découvrir le monde en grande partie "façonné" pour le séduire. Bien sûr, il devra voyager pour voir l'original de la Grande Muraille de Chine, mais il peut aussi se contenter de la version virtuelle sur un disque compact qu'il achètera au centre commercial. Il peut vouloir manger des escargots de Bourgogne selon la recette originale, mais nul besoin de se déplacer pour le faire : il peut en trouver en conserves, ou surgelés, ou séchés à froid.
Les rapports humains ont grandement souffert de l'implantation de ce tourisme. Pourquoi voyager si je peux trouver chez moi ce qui a vu le jour à des milliers de kilomètres de distance et qui s'y trouvent toujours ? Je n'aurai pas l'orignal, mais j'aurai ma copie à moi que je pourrai exhiber avec fierté. Et c'est ainsi que le superficiel devient une façon d'être.
Les véritables échanges entre humains sont devenus si difficiles qu'ils se sont progressivement confinés à des groupes spécialisés qui en font leur principale raison d'être : ici, on parle entre "savants", là, on parle, avec la voix du cœur des vraies choses de la vie. Partout ailleurs, il n'est question que de ce que tout le monde a vu ou entendu, ou plutôt de ce qu'on a bien voulu leur laisser voir ou entendre.
Celui ou celle qui ne pense pas comme les autres et qui le dit est, soit un excentrique, soit un génie, dans les deux cas, un marginal. Pour redécouvrir les joies non imposées, la spontanéité d'être, il faut revenir aux valeurs toutes simples qui m'amènent par exemple à débarquer chez un ami sans m'être annoncé. Je peux aussi faire une balade en allant sans ne rien décider à l'avance. Je peux lire les bouquins qui ne sont pas des succès de vente ou regarder les films que la critique n'a pas portés aux nues. Je peux aussi cuisiner au gré de ma fantaisie et décorer mon appartement sans me soucier des canons du dernier magazine à la mode.
Hier, entouré des siens, on mourait de la grippe, d'une indigestion, de la tuberculose. Aujourd'hui, on meurt de maladies liées à la sédentarité, à moins qu'on ne se suicide, las d'être seul devant son ordinateur à visiter le monde.
Au grand restaurant
Les derniers clients du déjeuner sont partis depuis près d'une heure. Les nappes n'ont pas été changées mais plutôt recouvertes d'une pièce de toile qui ne cache que le dessus de la table. Les serviettes de papier ont succédé aux serviettes de tissu. Les couverts d'argent ont été réduits au minimum : quatre pièces au lieu des sept ou huit habituelles. Et malgré le fait que des serveuses aient quitté pour l'après-midi, de même que l'hôtesse qui accueille habituellement les clients, la salle à manger du restaurant Kerhulu brille de tout son éclat, prête à recevoir les "cafetières", ces dames qui, chaque jour, entre quinze heures et dix-sept heures, parfois dix-huit heures, viennent prendre le thé.
Les deux premières ne tardent pas à arriver. L'assurance avec laquelle elles se dirigent vers une des tables de Lucie, une serveuse qui a vu naître le restaurant, ne laisse aucun doute : ce sont des habituées qui ont leur table, située dans la section de leur serveuse préférée, laquelle connaît leurs petits caprices, et bien d'autres choses à leur sujet.
On mange léger à cette heure. Ce n'est pas tellement la nourriture qui importe après tout comme le fait de rencontrer une amie ou une connaissance, ou d'être vue en présence d'une personnalité ou d'avoir la chance d'en voir une, mieux, d'y être présentée. Croissants et fines pâtisseries sont au menu. Si les premiers sont emportés dans une corbeille de jonc, savamment enveloppés dans un napperon, les gâteaux sont déposés sur la table dans un plateau d'argent. Dans certains cas, il faut présenter chacune des bouchées par leur nom avec moult détails sur leur contenu, dans d'autres cas, cela est inutile puisque les clientes les connaissent bien. Mais le choix est toujours long et difficile. Aussi, arrive-t-il que la serveuse laisse sur la table le plateau et la pince d'argent afin que les clientes se servent elles-mêmes. Le nombre de gâteaux aura été mentalement noté afin de préparer l'addition en conséquence.
Si le café est très populaire, le thé est aussi fort prisé. La théière argentée, remplie d'eau chaude, est soigneusement posée dans une assiette décorée d'un napperon de fantaisie. Même la place du sachet de thé montre que le hasard n'a pas ici sa place. Un petit pot de crème est déposé sur la table, lui aussi dans une assiette avec napperon, à moins que madame n'ait demandé du lait. Les quartiers de citron ne seront pas très loin. Et celle qui mélangera crème et citron sera recalée bien bas. Quant à celle qui n'aura demandé que de l'eau chaude à laquelle elle ajoutera son propre sachet de thé, elle sera tout à l'heure jugée et sévèrement condamnée par un tribunal formé à la hâte dans la cuisine. Les sacs à main sont placés sur le plancher, alors les emballages des grands magasins - Simon's, Holt Renfrew, Birks -sont bien en vue sur la table.
Les têtes s'agitent régulièrement pour saluer une nouvelle arrivée. Quelques mots sont parfois échangés : "La santé est bonne ?" "Celle de Monsieur ?" "Et la petite qui étudie chez les Ursulines ?" "Et l'aîné qui est au petit séminaire ?"
Une espèce de murmure traverse tout à coup la salle. C'est l'épouse du premier ministre qui vient d'arriver. Ses visites se font rares et on se demande ce qui l'amène à Québec, elle qui préfère demeurer à Montréal.
Ces convives ont une grande qualité : elles sont de fines dégustatrices. Jamais on ne mettra autant de temps à manger un croissant ou une pâtisserie dont on pourrait faire deux bouchées. Pas étonnant que l'on demande de réchauffer le café ou d'apporter à nouveau de l'eau chaude.
À seize heures, la salle est pleine et les premières arrivées quittent, laissant une pièce de monnaie en guise de pourboire. Mais toutes ces pièces réunies font un montant appréciable que Lucie, Alice et Lise ne manqueront pas de noter dans leur grand livre ce soir.
En haute saison, le grand restaurant voit défiler chaque jour des centaines de personnes, mais aucune n'a la fidélité de ces dames de l'heure du thé. Aucune ne reçoit également autant d'attention. L'hiver venu, quand les touristes seront partis, ce sont elles qui permettront d'écrire quelque chose dans le grand livre du restaurant et dans celui des pourboires.
Jean-Paul Quinty
De la philosophie du Moyen Âge
au modernisme du XXe siècle
S'il était
bedonnant, sa longue barbe grisonnante lui fournirait l'essentiel de ce personnage dont,
enfant, j'attendais la visite à Noël. Mais, à 58 ans, l'homme avec qui je prends un
café est mince.
Et si c'est la barbe qu'on remarque d'abord, on est vite fasciné par
ces yeux qui se posent ici et là comme s'ils ne pouvaient se fixer sur un point
précis. Ses longs doigts jouent dans la barbe taillée sans recherche.
Quelquefois, les bras et les mains gesticulent rapidement au rythme d'un
discours qui refuse de s'enflammer. On aimerait vois l'espièglerie dans les
yeux, mais c'est avec retenue, presque avec pudeur que se raconte Jean-Paul Quinty.
Une jeunesse dans la capitale mondiale du papier
Au début du siècle, Trois-Rivières était une ville que la fabrication
du papier avait rendue très prospère. Cette richesse matérielle avait
son pendant culturel : maisons d'enseignement, cercles musicaux, cercles
littéraires. Le tourisme était aussi très présent surtout à cause du
Vieux-Trois-Rivières qui faisait le charme de cette ville purement française.
En 1925, Jean-Paul y voit le jour. Aîné d'une famille de cinq enfants, le jeune
Trifluvien fait ses classes de musique. C'est d'abord dans une chorale d'enfants que
Jean-Paul met à profit la belle voix que, jeune, il avait. Pendant trois ans, il
fera partie de l'harmonie Lasalle. Plus tard, il pourra apprendre le solfège,
l'harmonie, le jeu des cuivres.
En rhétorique - puisqu'il a fait son cours classique, grâce à un confrère dont
le père composait des complaintes et arrangeait de vieilles chansons, il fait partie
d'un quatuor vocal dont le répertoire était constitué de ces vieilles chansons.
À la fin de ses études classiques, chacun va son chemin. Jean-Paul affûte ses
premières armes dans le milieu journalistique.
15 ans de journalisme
Âgé de 23 ans, Jean-Paul entre au Nouvelliste de Trois-Rivières en 1949.
Pendant six mois, il fera essentiellement de la traduction puisque toutes
les nouvelles, en provenance des agences de presse, sont transmises en anglais.
Plus tard, il apprendra à faire des titres et écrira de courts reportages :
petites incendies, comptes rendus de funérailles. On payait à l'époque pour
que la description des funérailles soit publiée. Les familles nombreuses donnaient
à cet événement une grande importance et l'on voulait que la presse y fasse écho.
En 1959, il quitte Le Nouvelliste pour La Presse. Et comme il avait
beaucoup appris de la fabrication d'un journal, il est nommé chef de pupitre des
bureaux régionaux. 1960 l'amènera à Québec où douze journalistes travaillent
pour La Presse. La aussi, il sera chef de pupitre.
1961. C'est l'aventure du Nouveau Journal. Jean-Paul est affecté à la production
à titre de responsable des projets spéciaux. Pendant quelques mois, il
sera à The Gazette où est imprimé de nouveau quotidien de langue française.
Le 23 juin, le Nouveau Journal est publié pour la dernière fois.
Co-fondateur d'une première école de journalisme
Jean-Paul, après avoir refusé une offre de La Tribune de Sherbrooke, se retrouve
au Soleil où il travaille de nuit à la production de ce quotidien et aussi de L'Événement, journal du matin. Il rétablit les ponts brisés entre la salle de rédaction et les ateliers.
En mars 1964, avec Normand Girard, et en collaboration avec Le Soleil et
l'Université Laval, il met sur pied des cours de journalisme où les étudiants,
la relève de demain, reçoivent une compensation financière. Quatre-vingts demandes
d'inscription sont reçues, vingt sont retenues et trois gradués sont embauchés
par Le Soleil : Gilbert Athot, Jacques Dumais et André Bellemarre.
La carrière journalistique de Jean-Paul prendra fin à cause, entre autres, de la
publication du « plan d'occupation » de la ville de Québec à l'occasion de
la visite de la reine, visite qui devait inscrire dans notre histoire le samedi de la matraque.
Le plan sur lequel Jean-Paul avait pu mettre la main était exposé sur
des feuilles laissées sur la table d'un restaurant : des membres de l'armée,
jouant aux cartes, y avaient inscrit les points des joueurs.
Une carrière de communicateur au gouvernement du Québec
En 1965, Jean-Paul est nommé directeur des communications au ministère de
la voirie. C'était l'époque des grand travaux à la veille d'Expo 67 : autoroutes,
pont de Trois-Rivières, étude sur le transport dans la région de Québec.
La fédération routière internationale, qui regroupe 125 pays, tient son congrès à
Londres en 1966. Jean-Paul y assiste. Et puisque le prochain congrès, celui de 1970,
aura lieu en Amérique, Jean-Paul doit mousser la candidature de la ville de Québec…qui
l'emporte sur Chicago, Los Angeles, Houston et Montréal.
Jean-Paul, pendant trois ans, voit à la promotion de ce congrès à travers le monde,
incluant l'Europe de l'Est et l'Amérique latine. Résultats : 5 800 personnes se
réunissent à Québec. C'est le plus gros congrès à avoir été tenu à ce jour par la
fédération routière internationale.
Nouveau défi en 1970 : visiter les villes où des édifices publics ont opté pour
l'aménagement paysager interne. Son rapport devait amener l'aménagement paysager dans
l'édifice G (nom d'alors de l'immeuble)) alors en construction puis dans d'autres
centres administratifs.
Cap sur Communication-Québec
Je saute volontairement quelques étapes de la carrière de Jean-Paul - pourtant pas
dénuées d'intérêt - pour arriver en 1973alors qu'il prépare sur le mini-réseau de
Communication-Québec alors existant, sur la possibilité de l'élargir, et sur la façon
d'organiser le service de renseignements.
De cette étude et des résultats d'un colloque tenu sur le sujet en 1974 découlent
un plan quinquennal qui donnera des assises solides à Comunication-Québec (C.-Q.).
Le plan s'est entièrement à quelques perturbations près dues à la crise économique.
Jean-Paul, pilier de Communication-Québec, est un précieux collaborateur de François Reny,
directeur général de cet organisme.
La musique, une ouverture sur le mysticisme
Jean-Paul Quinty, malgré un travail professionnel qui l'occupait grandement et qui
l'a souvent amené à voyager, s'est toujours intéressé à la musique.
Déjà, en 1947, il fondait un camp musical pour garçons. École de chant et de musique,
le camp existe toujours.
En 1978, une chorale mixte, formée pour la messe de minuit dans la paroisse de
Saint-Ignace-de-Loyola, est devenue de façon permanente un chœur mixte de
24 personnes - La Schola de Beauport - qui a fait une tournée en Europe en
1980 et qui se prépare à en faire une deuxième.
Marié et père de quatre enfants, mordus à des degrés divers de la musique,
Jean-Paul consacre ses loisirs à la Schola qu'il voudrait suffisamment bien
implantée pour qu'elle lui survive.
S'il garde un contact avec les philosophes du Moyen Âge, Jean-Paul
s'intéresse à notre monde contemporain. En fait, il veut savoir où on s'en va.
Il est un peu comme la société qui s'ennuie du mysticisme et qui cherche des valeurs,
des matières à réflexion, des guides.
Pour lui, la musique actuelle est décevante et si les jeunes sont fantastiques,
ils se sentent perdus, attirés ici et là, sans grand idéal à atteindre. Mais
demandons-leur de se surpasser en interprétant de la musique sacrée, comme
le chant grégorien, par exemple, et ils montreront qu'ils sont capables
de dépassement.
Lettre ouverte au maire de Québec
Monsieur Jean-Paul L'Allier
Maire de la ville de Québec
2, rue des Jardins
Québec (Québec)
G1R4S9
Monsieur le Maire,
Depuis quelques années, la ville de Québec se classe en tête du palmarès québécois des villes les plus mal administrées. Quand on examine avec attention les secteurs où l'on circule régulièrement, on comprend vitre comment cet honneur lui échoit. On comprend du même coup pourquoi nos impôts fonciers sont si élevés et comment une partie d'entre eux est gaspillée.
J'attire votre attention sur diverses situations afférentes à I'administration de la ville dont j'ai été témoin, voire qui me dérangent quotidiennement.
Feux de circulation, 1
La rue Saint-Augustin, entre les rues Saint-Joachin et Saint-Jean, est maintenant une rue piétonnière. Or, à l'intersection de la rue Saint-Jean, on a laissé les feux de circulation mis en place avant qu'une section de la rue Saint-Augustin ne soit piétonnière. Résultais: les piétions n'ont pas de signal qui leur soit réservé, d'une part, et les automobilistes qui circulent sur la rue Saint-Jean et qui veulent tourner à gauche sur Saint-Augustin, d'autre part, doivent attendre qu'un piéton veuille bien les laisser passer : situation dangereuse et ennuyeuse pour tous. Solution: adapter la signalisation actuelle pour qu'elle ne desserve plus les automobilistes circulant sur la rue piétonnière mais qu'elle réserve plutôt une phase pour les piétons circulant dans toutes les directions et une phase pour les automobilistes qui désirent, soit tourner à gauche sur la rue Saint-Augustin, soit continuer tout droit sur la rue Saint-Jean. Comment se fait-il qu'aucun de vos ingénieurs en circulation n'y ait pensé? Personne ne marche dans ces rues?
Feux de circulation, 2
Quand on se rend aux Galeries de la Capitale, aux magasins
entrepôts RONA ou Réno Dépôt si on y accède par l'autoroute de la
Capitale, en utilisant la sortie Pierre-Bertrand, par exemple, on est plongé
dans plusieurs rues - Bouvier et Marais - où la circulation est infernale à cause de
l'absence de feux de circulation. Il est impensable qu'à des carrefours aussi
achalandés, il n'y ait pas de feux de circulation, les automobilistes doivent
composer avec des panneaux Arrêt, qui ralentissent grandement la circulation et
qui peuvent entraîner des accidents. Il me semble que les importants impôts fonciers
payés par les divers commerces desservis par ces artères pourraient justifier l'installation
de feux de circulation.
Panneau de prescription absolue du mauvais côté de la rue
Des travaux ont été effectués en bas de la côte de la Potasse. Comme on l'avait fait il y a quelques années, à la suite de travaux également, on a replacé le panneau de prescription absolue Arrêt à la gauche des chauffeurs plutôt qu'à la droite comme le stipule le code de la route. Cela sème la confusion et peut même être la cause de graves accidents.
Trottoirs en pavés
Les trottoirs en pavés comme ceux qu'on a faits sur la rue Saint-Jean, à l'ouest de l'autoroute Dufferin la monstrueuse, sont fort jolis mais encore faut-il qu'ils soient bien faits. Les problèmes surviennent là où on n'a pas utilisé des pavés mais du béton, autour des valves d'aqueduc, par exemple. Puisqu'on a étendu un ou deux pouces de béton sur une surface plus ou moins bien apprêtée pour le recevoir, tout a cassé après quelques mois. Et on fait et refait depuis sans, semble-t-il, se soucier de trouver une solution durable. Cette solution semble cependant exister. Quand on a pavé la section piétonnière de la rue Saint-Augustin, on a bien pris soin de tailler les pavés pour qu'ils remplissent tous les espaces de sorte qu'on n'ait pas à couler du béton. Le test d'un hiver a été passé avec succès.
Le cancer qui ronge le pavage de la place D'Youville, entre autres
Depuis qu'on a refait la place D'Youville, au milieu des années 80, le pavage a été, dès la première année rongé par le gel et le dégel, particulièrement par l'eau qui s'infiltre dans les joints de dilatation qui ne sont en fait que des traits de scie à béton dans lesquels on met un peu de tire-joint bitumineux qui scelle la fente pendant quelques semaines, tout au plus quelques mois. L'eau, le froid, la glace se chargent de briser ensuite ces joints. Par la suite, on met des pièces, on scie le béton, on remet d'autre béton, bref, on dépense chaque année des milliers de dollars. Je ne sais pas s'il y a une meilleure façon de faire, ou si un béton différent devrait être utilisé, mais la technique utilisée pour la place D'Youville est inadéquate. Or, on a utilisé la même méthode quand on a coulé des dalles de béton à divers endroits, sur la rue Saint-Joachin, I'été dernier. Il faudra voir si elles résisteront plus longtemps.
Toilettes publiques à la place D'Youville
Il est incroyable qu'on ne retrouve pas de toilettes publiques à la place D'Youville. Ce sont les restaurants qui doivent dépanner les personnes qui ont besoin, à moins qu'ils n'aient pas de toilettes, comme c'est le cas du restaurant Subway. Dans certains cas, les besoins sont satisfaits un peu partout comme j'ai vu le faire à plusieurs reprises. À Paris même, on a pourtant installé des toilettes publiques qui sont sécuritaires, propres esthétiques; pourquoi ne ferait-on pas la même chose à Québec.
Vivre avec le dos du centre des congrès dans la figure
Je suis un citoyen dont une partie de la vue donne sur l'arrière du centre des congrès. Ce n'est pas particulièrement laid, mais ça n'amène pas grand monde dans un quartier où les commerces ne pourraient que tirer avantage de la présence des congressistes. Or, il semble qu'on ait voulu faire vivre ces visiteurs en vase clos. Si l'on veut marier la vocation résidentielle et commerciale d'un secteur, on devrait permettre aux commerçant qui y ont pignon sur rue de faire des affaires avec les visiteurs de la ville. La plupart de ces visiteurs, présentement, s'arrêtent à la porte Saint-Jean, s'ils sont venus voir le Vieux-Québec, ou demeurent dans la forteresse verre-et-béton Hilton-centre-des-congrès-Radisson.
Cette lettre témoigne de l'intérêt que j'ai pour la ville de Québec en même temps qu'elle montre l'incurie de ceux qui travaillent à l'hôtel de ville. J'espère que mes remarques et suggestions seront dirigées vers les personnes qui pourront y donner des suites concrètes.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, I'expression de mes sentiments distingués.
La communication :
un acte souvent inachevé
Des êtres vivants, l'homme est celui qui possède les langages les plus évolués. Il peut exprimer les plus subtils concepts. Il a la possibilité d'entrer en communication avec ses semblables et de rendre ainsi possibles des contacts avec l'esprit, voire le cœur. Ces contacts sont ce qu'il y a de plus divin. Ils demandent cependant que la communication soit un acte achevé.
Dans une entrevue qu'il donnait il y a quelques mois, Alexandre Jardin, parlant d'une maîtresse que son père avait amenée à la maison, disait tout le bonheur que cette femme avait ressenti quand elle s'était rendu compte que dans cette famille, elle pouvait être elle-même puisque personne et rien n'était censuré, encore mois jugé d'après les critères habituels de la bonne société.
Ce jeune auteur venait de nous révéler un des secrets inhérents à la communication. Quand je parle avec quelqu'un, que mon discours n'est pas constamment censuré, je me sens rafraîchi, voire libéré. Si, de plus, mon interlocuteur ne me donne pas de conseils non sollicités et ne me juge pas constamment avec des phases qui bien que prononcées innocemment, contiennent leur dose de jugement sous la forme de "Tu n'as pas peur de faire cela ?", "Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi maintenant ?"
Avec quelqu'interlocuteur que ce soit, on ne passe pas au salon immédiatement. Avec certains, on reste sur le palier. Mais si la communication est établie, si chacun livre une parie de lui-même sans se censurer, le courant passe, le miracle se produit. En plus de rendre les échanges intéressants, ils nous donnent de l'assurance en nous fournissant l'occasion de nous présenter comme quelqu'un de correct, quelqu'un qui a vécu diverses expériences mais qui n'est pas dépourvu de valeurs pour cela.
Avec tous les moyens de communication qui sont à notre disposition, il est malheureux de constater que la plupart des gens ne communiquent pas vraiment. Avec un peut d'attention et d'effort, ils pourraient faire de la communication un acte achevé et découvrir tous ses charmes.
|